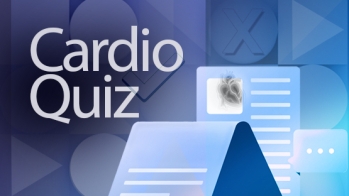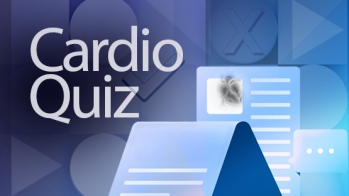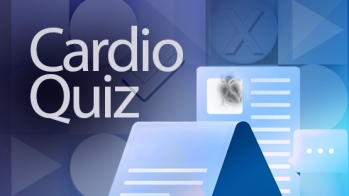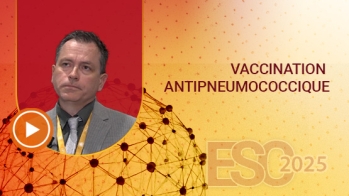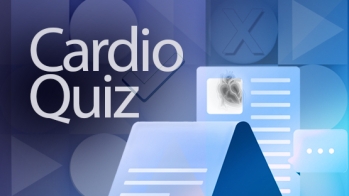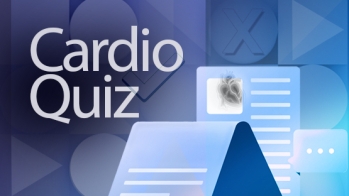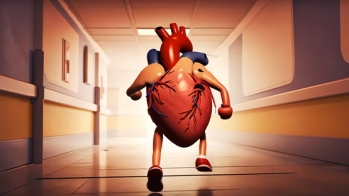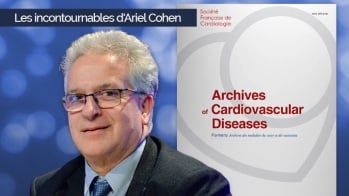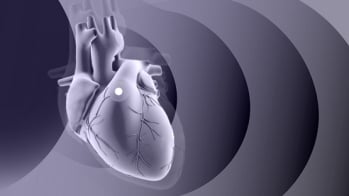Archives des Maladies du Cœur et des Vaisseaux - La sélection du mois : actualités du syndrome coronaire aigu
Publié le mercredi 10 décembre 2025
Cardio-online vous accompagne au quotidien avec une veille scientifique rigoureuse sur tous les grands thèmes de la cardiologie : articles, cas cliniques, vidéos… Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières nouveautés et enrichir votre pratique.