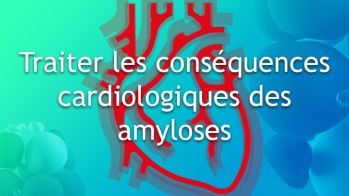5 minutes de lecture
Cardiopathie amyloïde : les sujets âgés particulièrement concernés
Publié le jeudi 9 novembre 2023
Dr Julien Le Guen
Praticien Hospitalier en gériatrie
Hôpital Européen Georges Pompidou
Paris
La majorité des cardiopathies amyloïdes est en rapport avec des dépôts tissulaires de transthyrétine (amylose ATTR mutée ou « sauvage ») ou de chaînes légères (amylose AL).
L’amylose ATTR « sauvage » est également appelée « sénile », par son association au grand âge. Les gammapathies monoclonales sont également plus fréquentes avec l’âge croissant, et concernent environ un pour cent de la population générale.
Rien de surprenant, donc, à ce que l’on observe, dans les grandes cohortes de patients atteints d’amylose, une moyenne d’âge élevée.
En parallèle, l’insuffisance cardiaque, toutes causes confondues, concerne des populations de plus en plus âgées : en France, on estime qu’environ deux tiers des patients hospitalisés pour ce motif ont plus de 75 ans. Au sein de cette population, l’insuffisance cardiaque est une cause majeure de morbidité avec un risque majoré de décès, d’hospitalisations, de perte d’autonomie fonctionnelle et d’altération de la qualité de vie. Parmi les patients âgés, plus de la moitié présente une insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée.
La connaissance épidémiologique des cardiopathies amyloïdes nécessite d’être affinée, mais l’émergence et la diffusion des techniques diagnostiques moins invasives permet d’estimer à environ 20 % la prévalence des cardiopathie amyloïdes après 65 ans, lorsque l’on combine des critères d’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée et d’hypertrophie ventriculaire gauche.
La cardiopathie amyloïde est rare avant 70 ans. Mis en perspective avec le vieillissement de la population globale, on mesure l’importance de sensibiliser les acteurs de la santé à ces pathologies.
Grandes particularités des sujets âgés : hétérogénéité, fragilité, poly-morbidité/poly-médication
Une des caractéristiques de la population âgée est sa grande hétérogénéité en termes d’état de santé et d’autonomie. On observe ainsi dans toutes les spécialités de plus de plus de patients âgés, voire très âgés, en bonne forme, autonomes et dont les comorbidités sont stables et peu invalidantes. À l’inverse, nombreux sont les sujets âgés mais aussi plus jeunes dont l’état de santé ne permet pas d’envisager un réel bénéfice aux approches thérapeutiques actuelles des pathologies amyloïdes. Premier constat : il semble donc peu pertinent de retenir l’âge chronologique comme seul critère décisionnel aux explorations diagnostiques et aux thérapeutiques existantes.
Au sein de ces personnes âgées, nombreuses sont celles qui présentent un état dit "de fragilité". La fragilité est un syndrome distinct des autres « syndromes gériatriques » (telles que les pathologies cognitives ou les chutes répétées), défini par une « diminution des réserves physiologiques et des capacités de l’organisme à faire face à un stress ». Si tous les sujets âgés ne sont pas fragiles, ce syndrome est plus prévalant avec l’âge croissant, et lorsqu’il est présent, il est associé à un surrisque indépendant de morbidité, de mortalité, d’hospitalisations fréquentes et de perte d’autonomie. Le principal substratum anatomique de la fragilité est la perte de masse musculaire, ou sarcopénie. S’il n’existe pas d’outil de mesure consensuel, plusieurs échelles permettent de la dépister. Dans une étude récente menée par le Centre National de référence amylose de l’hôpital Henri Mondor, à Créteil, entre un tiers et la moitié de patients souffrant d’une cardiopathie amyloïde (ATTWt), présentait un syndrome de fragilité. La fragilité mesurée était par ailleurs plus sévère et plus prévalente avec la durée d’évolution de la maladie et, de manière concordante avec d’autres travaux hors pathologie amyloïde, associée à un risque majoré de décès et d’hospitalisation. Une hypothèse avancée est que la pathologie amyloïde en elle-même, par ses atteintes diffuses (notamment neurologiques, digestives ou rhumatologiques) contribue spécifiquement à aggraver la fragilité et son retentissement.
Les sujets âgés accumulent dans le temps les risques de développer des pathologies chroniques multiples et, en conséquence, de devoir suivre de nombreux traitements médicamenteux : on parle ainsi de polypathologie et de polymédication. On estime, en France, que les plus de 80 ans souffrent en moyenne de 4 à 7 pathologies chroniques nécessitant 5 à 12 traitements différents. Cette polymédication favorise elle-même le risque d’interactions et d’iatrogénie médicamenteuse. L’évaluation précise de ces comorbidités et de leur impact est primordiale tant elle guidera les objectifs de la prise en charge et les décisions aux niveaux diagnostiques et thérapeutiques.
Les traitements spécifiques des cardiopathies amyloïdes ont un coût élevé, majorant, en association avec d’autres traitements, le risque iatrogénique, leur impact positif ne pouvant ainsi se mesurer qu’à relativement long terme. Il est par conséquent important d’identifier, au sein des patients les plus âgés, ceux qui en bénéficieront le mieux. Enfin, ajoutons que la prise assidue et donc l’efficacité attendue des traitements est améliorée par le dépistage des difficultés cognitives et sociales qui peuvent entraver une observance optimale.
Intérêt d’impliquer les gériatres aux parcours de soins
Les compétences et le temps nécessaires pour identifier ces spécificités justifient pleinement l’intégration de la gériatrie au sein des centres de référence amylose.
L’intérêt d’adresser un patient âgé en consultation de gériatrie est d’abord de permettre, à travers l’évaluation la plus multidimensionnelle possible, un diagnostic de l’état de santé global. L’évaluation gériatrique standardisée nécessite un temps long (environ 1h00 à 1h30), l’utilisation d’échelles dédiées aux différents champs explorés : cognition, état thymique, comorbidités, polymédication, risque de chute, autonomie fonctionnelle, nutrition, environnement social. Elle permet ainsi de prioriser les différentes interventions et de proposer un plan de soins et d’aides adapté et individualisé.
Ce plan de soins mobilise des professionnels de santé médicaux et paramédicaux : infirmiers, kinésithérapeutes, services d’aides à la personne, psychologues, travailleurs sociaux…
Conclusion
Si tous les patients âgés, notamment les plus en forme, ne relèvent pas formellement d’un tel niveau d’intervention, il n’existe pas, à l’heure actuelle, d’outil validé permettant d’orienter vers une évaluation gériatrique tel ou tel patient dans le domaine des pathologies amyloïdes. On peut cependant, au moyen d’éléments simples d’interrogatoire et d’examen (mobilité réduite, chutes répétées, polymédication, fragilité cognitive), identifier ceux qui devraient ainsi être évalués par des gériatres.
Références
- Frailty in Wild-Type Transthyretin Cardiac Amyloidosis: The Tip of the Iceberg - PubMed (nih.gov) - Broussier A, David JP, Kharoubi M, Oghina S, Segaux L, Teiger E, Laurent M, Fromentin I, Bastuji-Garin S, Damy T. - J Clin Med. 2021 Jul 31;10(15):3415. doi: 10.3390/jcm10153415. PMID: 34362197; PMCID: PMC8348590.
- Estimating the Prevalence of Cardiac Amyloidosis in Old Patients with Heart Failure-Barriers and Opportunities for Improvement: The PREVAMIC Study - PubMed (nih.gov) - Ruiz-Hueso R, Salamanca-Bautista P, Quesada-Simón MA, Yun S, Conde-Martel A, Morales-Rull JL, Suárez-Gil R, García-García JÁ, Llàcer P, Fonseca-Aizpuru EM, Amores-Arriaga B, Martínez-González Á, Armengou-Arxe A, Peña-Somovilla JL, López-Reboiro ML, Aramburu-Bodas Ó; PREVAMIC Investigators Group. - J Clin Med. 2023 Mar 15;12(6):2273. doi: 10.3390/jcm12062273. PMID: 36983274; PMCID: PMC10057876.
Retrouvez l'intégralité du dossier spécial : "Prise en charge globale du patient avec amylose cardiaque"
Ce contenu vous est proposé avec le soutien institutionnel de Alnylam
Dans la même thématique
Articles les plus lus

Traiter les conséquences cardiologiques des amyloses
Publié le 25 octobre 2023
Dépistage et évaluation de la neuropathie amyloïde familiale à transthyrétine
Publié le mercredi 25 octobre 2023
Cardiopathie amyloïde : une approche nécessairement globale et multidisciplinaire
Publié le jeudi 9 novembre 2023