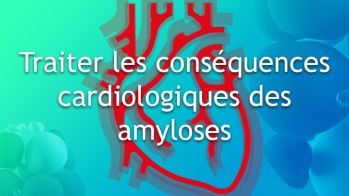3 minutes de lecture
Cardiopathie amyloïde : une approche nécessairement globale et multidisciplinaire
Publié le jeudi 9 novembre 2023
Dr Julien Le Guen
Praticien Hospitalier en gériatrie
Hôpital Européen Georges Pompidou
Paris
Les amyloses, par leur processus physiopathologique (les dépôts fibrillaires), peuvent se manifester par l’atteinte de nombreux tissus et organes. En cela, elles rencontrent toutes les caractéristiques des pathologies systémiques, et nécessitent par conséquent une approche multidisciplinaire coordonnée.
Une approche diagnostique multidisciplinaire
Le "gold standard" diagnostique repose sur l’identification et le typage de dépôts amyloïdes au niveau tissulaire : biopsies de glandes salivaires accessoires, biopsie de graisse abdominale, de muqueuse rectale, voire de tissu myocardique. L’analyse des prélèvements nécessite un haut niveau de compétences, et le recours à des techniques de plus en plus spécialisées d’anatomopathologie (microscopie électronique notamment).
L’analyse génétique nécessaire pour identifier les formes familiales mobilise également des compétences très spécialisées et des consultations dédiées.
L’émergence des techniques d’imagerie telles que l’IRM cardiaque ou l’utilisation de radio-isotopes (scintigraphie osseuse) fait appel aux médecins radiologues et nucléaristes, et permet ainsi, dans certains cas, de ne pas avoir recours aux techniques invasives pour affirmer un diagnostic positif d’amylose.
Et une approche thérapeutique multidisciplinaire
L’atteinte cardiaque au cours d’une pathologie amyloïde est associée aux pronostics les plus sévères en termes de morbidité et de mortalité. C’est également celle qui a bénéficié des progrès diagnostiques et thérapeutiques les plus significatifs.
Les atteintes extra-cardiaques ne doivent néanmoins pas être négligées, car elles ont potentiellement un impact majeur sur l’état de santé globale et le retentissement de la maladie.
- L’atteinte auditive se traduit par une hypoacousie touchant l’ensemble des fréquences auditives, se différenciant ainsi de la perte observée dans la presbyacousie qui, elle, prédomine aux fréquences élevées. Cette atteinte est fréquente et précède souvent les symptômes cardiaques. Ses conséquences, en l’absence de correction, ne sont pas directement vitales, mais sont néanmoins sources d’isolement social, de troubles de l’humeur, et aggravent un éventuel déclin cognitif.
- L’atteinte neurologique est pluriforme. Secondaire aux infiltrations compressives périphériques (canal carpien, canal lombaire rétréci par exemple) ou se manifestant par des neuropathies sensitives, elle est source de douleurs et de troubles de la marche favorisant les chutes et l’incapacité fonctionnelle. L’atteinte du système nerveux autonome, autre mécanisme lié aux infiltrations amyloïdes, provoque une hypotension orthostatique parfois sévère, cause fréquente de chutes et de troubles de la marche.
- Les dépôts musculo-tendineux peuvent s’observer (ruptures tendineuses scapulaires notamment) et ainsi aggraver le retentissement fonctionnel.
- L’atteinte digestive, secondaire à la dysautonomie ou liée à l’infiltration directe des muqueuses, est associée à des troubles digestifs fonctionnels parfois invalidants, et à un surrisque de dénutrition et de fonte musculaire.
- L’atteinte rénale, souvent liée aux dépôts glomérulaires, se manifeste le plus souvent par un syndrome néphrotique et une insuffisance rénale progressive qui peut conduire aux techniques d’épuration extra-rénale.
- Enfin, dans le cas des amylose AL, les traitements proposés reposent sur des thérapeutiques de chimiothérapie et/ou de thérapies ciblées spécifiques prodiguées au sein des services d’hématologie.
Conclusion
Pour permettre une intervention thérapeutique efficace, l’ensemble des atteintes liées à la pathologie amyloïde doivent donc être dépistées, évaluées et prises en charge conjointement, afin d’atténuer le fardeau global de la maladie.
On mesure bien, à travers ces exemples, la nécessité de mobiliser de manière coordonnée différentes spécialités médicales, biologiques, radiologiques, voire chirurgicales tant dans l’approche diagnostique que thérapeutique. Cette approche globale ne se limite pas au seul corps médical et fait aussi appel aux autres acteurs de la santé et du secteur médico-social : infirmières spécialisées, kinésithérapeutes, audioprothésistes, assistantes sociales, etc.
Un tel niveau de compétences coordonnées a ainsi justifié la mise en place de réseaux dédiés à l’amylose au sein de centres experts, comme c’est le cas dans les hôpitaux du groupe Paris Centre. Plusieurs référents, dans chaque spécialité concernée, sont ainsi identifiés et contribuent, tant à faciliter les parcours diagnostiques et de soins, qu’à améliorer des connaissances scientifiques de ces pathologies.
Retrouvez l'intégralité du dossier spécial : "Prise en charge globale du patient avec amylose cardiaque"
Ce contenu vous est proposé avec le soutien institutionnel de Alnylam
Dans la même thématique
Articles les plus lus

Traiter les conséquences cardiologiques des amyloses
Publié le 25 octobre 2023
Dépistage et évaluation de la neuropathie amyloïde familiale à transthyrétine
Publié le mercredi 25 octobre 2023
Cardiopathie amyloïde : les sujets âgés particulièrement concernés
Publié le jeudi 9 novembre 2023