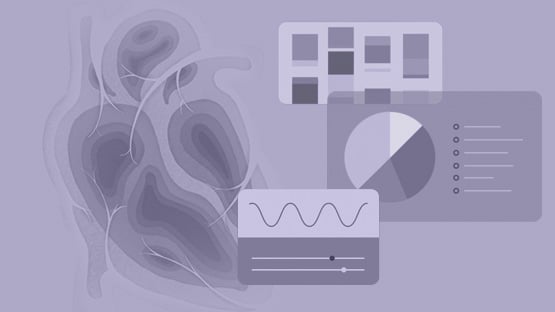3 minutes de lecture
Les méthodes de détection de la non-adhésion thérapeutique
Publié le lundi 21 mars 2022
Dr Benjamin Kably
Pharmacologue
HEGP, Paris
Afin de pouvoir prendre en charge de manière efficace la non-adhésion thérapeutique, il est important de disposer de méthodes de détection fiables et accessibles.
Historiquement, les premières méthodes à avoir été utilisées sont des méthodes dites « subjectives ». La simple intuition du médecin pour juger de l’adhésion thérapeutique des patients est très imprécise et inexacte dans la plupart des cas.
Les questionnaires standardisés et les formulaires d’auto-évaluation sont facilement manipulables par les patients et souffrent d’un manque de sensibilité diagnostique, tendant généralement à surestimer l’adhésion thérapeutique ; leur utilisation seule n’est pas recommandée.
Compte-tenu de ces limites, des méthodes objectives d’évaluation de l’adhésion thérapeutique ont été développées. Les méthodes « objectives indirectes », comme par exemple le comptage des comprimés, le recueil des données de dispensation pharmaceutique ou des données issues de l’Assurance Maladie, ou encore l’analyse des renouvellements d’ordonnance à la pharmacie, sont surtout utilisées en recherche clinique.
D’autre part, certains biomarqueurs de l’activité pharmacodynamique de certains médicaments cardiovasculaires peuvent être utilisés pour évaluer l’adhésion thérapeutique (ralentissement de la fréquence cardiaque sous bêtabloquant, hyperuricémie sous diurétique, augmentation de la concentration de rénine plasmatique sous IEC, ARA2 ou diurétique, augmentation de la concentration d’acétyl-ser-asp-lys-pro (AcSDKP) sous IEC…).
Il existe enfin des méthodes dites « objectives et directes », dont les piluliers électroniques et les méthodes analytiques de détection médicamenteuse. Les piluliers électroniques, qui enregistrent leur ouverture (mais ne préjugent pas de la prise médicamenteuse), permettent l’accès à une information longitudinale sur le comportement des patients vis-à-vis de leur traitement (périodes d’arrêt du traitement courtes ou longues, variabilité de l’heure de prise, oublis ponctuels…) pouvant guider la prise en charge. Ils ont été utilisés dans les protocoles de recherche clinique mais sont difficiles à mettre en œuvre en pratique de routine, notamment du fait de leur coût.
Les méthodes analytiques, majoritairement de chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse (LCMS), permettent la détection des médicaments dans un échantillon biologique (sang, urine (de préférence), mais aussi cheveux, salive). Plusieurs méthodes de « screening », déjà publiées, permettent la détection simultanée de plus de 40 médicaments antihypertenseurs (27 à l’HEGP) dont le résultat est confronté à la prescription. Les patients sont informés et donnent leur consentement. L’absence d’un ou plusieurs médicaments dans l’échantillon biologique signe la non-adhésion thérapeutique pour des périodes précédant le recueil d’environ 3 à 15 jours. |
Ces méthodes présentent l’avantage d’évaluer avec précision l’état d’adhésion du patient au moment de la consultation médicale. Elles permettent d’apporter la preuve de la prise médicamenteuse à un moment précis, mais ne préjugent pas du comportement futur du patients, l’adhésion thérapeutique étant un phénomène dynamique au cours du temps.
Enfin, une détection positive peut être liée à une adhésion factice ou « blouse blanche » (patients ne prenant leurs médicaments qu’à l’approche de la consultation).
Retrouvez l'intégralité du dossier spécial "Les maladies chroniques et l’adhésion thérapeutique (HTA, hypercholestérolémie, etc.)"
Ce contenu vous est proposé avec le soutien institutionnel de Alnylam
Cet article a pour objectif de fournir des informations sur l'état actuel de la recherche ; les données présentées peuvent être susceptibles de ne pas être validées par les Autorité de santé.
Le laboratoire Alnylam n'est pas intervenu dans le choix et la rédaction du contenu scientifique.
Le contenu scientifique a été réalisé sous la seule et entière responsabilité des auteurs et du directeur de la publication, qui sont garants de l'objectivité de cette publication.
Dans la même thématique
Articles les plus lus
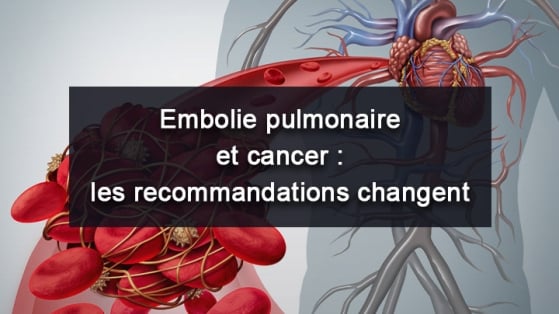
Embolie pulmonaire et cancer : les recommandations changent
Publié le 17 février 2022
De nouvelles stratégies de prise en charge pour les patients intolérants aux statines
Publié le jeudi 3 novembre 2022
L’hypertension artérielle : un fléau que l’on peut vaincre
Publié le mercredi 2 février 2022
Incidence non négligeable des myocardites après 3ème dose de vaccin à ARN messager anti-COVID 19
Publié le samedi 27 août 2022
Quelle place pour les biomarqueurs cardiaques en cardio-oncologie ?
Publié le mardi 27 septembre 2022