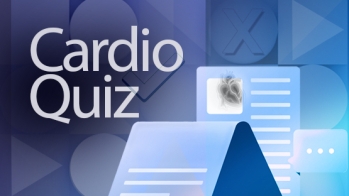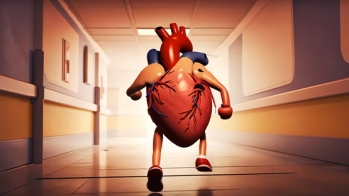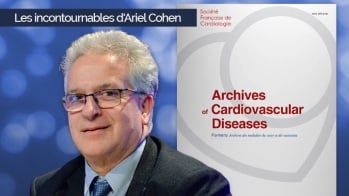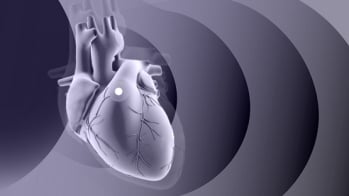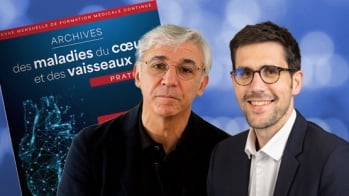Cœur et recherche – Les jeunes à l’œuvre !
Publié le lundi 29 septembre 2025
Cardio-online vous accompagne au quotidien avec une veille scientifique rigoureuse sur tous les grands thèmes de la cardiologie : articles, cas cliniques, vidéos… Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières nouveautés et enrichir votre pratique.