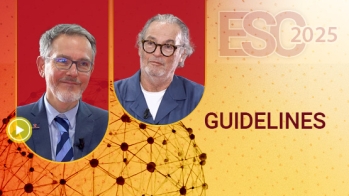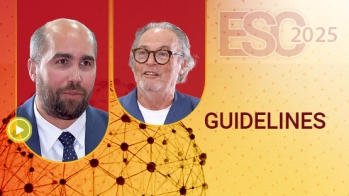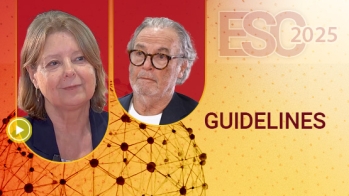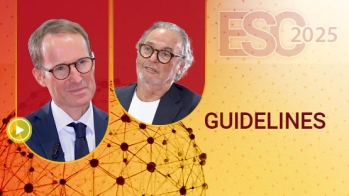Recommandations ESC 2025 sur la prise en charge de la grossesse et des maladies cardiovasculaires : les messages à retenir
En direct du congrès de l'ESC 2025
Le président de la SFC, Bernard Iung, résume, dans cet entretien réalisé avec Serge Kownator à l'ESC 2025, ce qu'il faut retenir des nouvelles recommandations sur la grossesse et les maladies cardiovasculaires. Ces guidelines, explique-t-il, “renforcent un certain nombre de recommandations précédentes”.
Publié le jeudi 4 septembre 2025
Retranscription de l'entretien
Dr Serge Kownator : À l'ESC 2025 à Madrid, on a présenté les recommandations sur cœur et grossesse. Pour en parler, je suis avec le Pr Bernard Iung, président de la Société Française de Cardiologie. Ces recommandations, Bernard, elles démarrent à la préconception, elles couvrent toute la grossesse et le post-partum. Que retenir ?
Pr Bernard Iung : C’est vaste et difficile parce que les cardiopathies en cours de grossesse sont des situations extrêmement hétérogènes. Bien sûr, on ne peut pas tout résumer en quelques minutes. Dans les points importants, ces recommandations n'apportent pas de bouleversement majeur mais elles renforcent un certain nombre de recommandations précédentes, grâce à des données qui se sont accumulées depuis, notamment celles issues du registre européen sur les cardiopathies et la grossesse.
Alors quelque chose qui existait déjà auparavant, c'est la notion de pregnancy heart team, d'équipe multidisciplinaire, qui est, cette fois-ci, mise en avant de façon beaucoup plus précise et en particulier avec des recommandations gradées : une recommandation de classe 1 sur le fait que les patientes qui ont une cardiopathie de classe OMS modifiée de 3 ou supérieure doivent être référées à un centre expert pour, idéalement, la consultation pré-conceptionnelle et puis tout le suivi de la grossesse et l'accouchement. Les classes OMS 1 et 2 peuvent être suivies dans des centres non spécialisés. C'est donc plus précis que ce que l'on avait auparavant. C'est important parce que ce sont des pathologies qui sont relativement rares et il est important qu'un praticien puisse devant une cardiopathie connue avoir une première orientation.
SK : Ces classifications de l'OMS nous servent à stratifier le risque ?
BI : C'est celle qui est recommandée maintenant. Il y en a d'autres, mais celle-là est relativement simple. Elle a été très largement validée et en fonction du niveau de risque, elle recommande la fréquence des consultations, le lieu de la prise en charge de la grossesse, de la prise en charge de l'accouchement, donc vraiment des recommandations pratiques.
SK : Et puis elle couvre de manière individuelle les différents types de pathologies, rythmiques, valvulaire, aortique…
BI : Cela permet, je dirais en un coup d'œil, de savoir si l’on est sur une cardiopathie à risque modéré ou à haut risque et c'est quand même très important dès le départ.
SK : Et puis il y a les interactions avec les médicaments également qui sont abordées.
BI : Il y a, comme dans les recommandations précédentes, une large part sur les médicaments et leur classe en fonction des données de pharmacovigilance. C'est-à-dire les médicaments qui sont contre-indiqués, ceux pour lesquels on ne sait pas trop, qu'il vaut mieux éviter, ou ceux qu'il faut privilégier. C'est important de se référer à ces classifications parce que, là aussi, tout le monde ne peut pas tout connaître sur le bout des doigts.
SK : Bien sûr, de la même manière chaque type de pathologie est pris en charge, ça va finalement du conseil pré-conceptionnel jusqu'à finalement la prise en charge, l'autorisation de la grossesse, la prise en charge.
BI : Alors, idéalement la consultation pré-conceptionnelle… Malheureusement, on est encore confronté assez souvent à des femmes chez qui la cardiopathie est prise en charge en cours de grossesse, soit parce qu'elle était totalement méconnue auparavant, soit parce qu'elle était connue mais parce qu’il n’y a pas eu d'évaluation et cela peut conduire à des situations difficiles. C’est toujours mieux d'avoir une évaluation préalable.
SK : Et puis, pour les patientes qui ont des cardiopathies, notamment des valvulopathies, des recommandations ont évolué quant à la stratégie, notamment pour la chirurgie valvulaire.
BI : On sait que la chirurgie valvulaire en cours de grossesse est à haut risque, surtout pour le fœtus. Maintenant, il y a une recommandation de grade 1 qui est que la chirurgie doit être envisagée en cours de grossesse que dans des situations de sauvetage maternel. Bien sûr, dans ces cas-là, il faut l'utiliser, mais dans les autres cas, il faut savoir être attentiste, notamment, par exemple, dans des valvulopathies régurgitantes, même sévères. On sait que la tolérance est généralement bonne. Il faut un suivi strict, mais on va bien sûr tout faire pour éviter une intervention, sauf encore une fois sauvetage maternel. À l'opposé, pour les valvulopathies sténosantes dont on sait qu'elles sont plus mal tolérées, la mise en avant de plus en plus des techniques percutanées, dilatation mitrale dans la sténose rhumatismale, qui est la plus mal tolérée, dilatation aortique voire maintenant TAVI dans les sténoses aortiques mal tolérées.
SK : Le choix de la prothèse peut être impacté ?
BI : Alors, chez les femmes jeunes qui doivent avoir un remplacement valvulaire, le fait de privilégier une bioprothèse qui était avant une recommandation de classe 2A est passée à une recommandation de classe 1, donc, c'est vraiment beaucoup plus fort et c'est tout à fait logique quand on connaît la complexité et les complications de la prise en charge des grossesses chez les femmes qui ont des prothèses mécaniques, en raison des difficultés de prise en charge du traitement anticoagulant et des complications inhérentes. C'est sûr que les femmes jeunes vont avoir des dégénérescences rapides de leur bioprothèse, mais notamment la possibilité de faire maintenant des techniques de valve-in-valve, de cardiologie interventionnelle et de repousser l'échéance d'une réintervention favorise l'élargissement de ces indications de bioprothèse.
SK : Un mot sur la gestion des anticoagulants ?
BI : Comme auparavant, la nécessité d'une discussion multidisciplinaire impliquant la patiente favorisant plutôt la poursuite des antivitamines K durant la totalité de la grossesse, en particulier si la dose d'antivitamine K est faible, une dose de coumadine ou équivalent inférieur à 5 mg. Il faut également prendre en compte l'adhésion au traitement et, par exemple, un relais héparinique doit impérativement s'associer à une surveillance régulière de l'activité anti-X, ce qui est contraignant et qui est parfois difficile à faire en ville. Donc tout ça doit être anticipé, doit être intégré dans une discussion. Il n’y a pas de règle simple, et encore une fois ce type de situation, la grossesse chez les patientes porteuses de prothèse mécanique doit vraiment être prise en charge dans des centres spécialisés parce que ce sont des situations à risque même si on essaie de suivre les recommandations au mieux.
SK : On arrive au terme de la grossesse, les modalités d'accouchement ?
BI : Alors, là aussi renforcement d'une recommandation existante mais avec des données encore plus solides notamment du registre européen ROPAC, c'est que lorsque la cardiopathie est stable et reste bien tolérée, l'accouchement par voie basse à terme est possible et sûr et vraiment la modalité à privilégier. Il y a une nouvelle contre-indication qui est de ne pas faire d'accouchement avant 39 semaines en cas de cardiopathie stable, de principe. C'est important parce que ça reste quelque chose qu'on voit en pratique des accouchements plus précoces chez des patientes cardiopathes. Si c'est bien toléré, il n’y a pas vraiment de raison.
SK : Merci Bernard, ces recommandations sont effectivement très vastes, on ne peut pas les détailler en quelques minutes bien sûr, mais je pense que ce qu'il faut vraiment souligner, c'est que tout praticien, même s’il n’est pas spécialisé dans le domaine peut s'y référer au moins pour la prise en charge initiale.
Toute l'actualité de l'ESC 2025
La couverture de ce congrès vous est proposée avec le soutien institutionnel de :